/
/
/
L'absence de trace écrite ne nous permet pas de fixer avec précision la date de création du village di U Pighjolu. Mais par contre la présence, connue depuis longtemps, des ruines d'une chapelle datant vraisemblablement du X° siècle (d'après Mme Moracchini-Mazel) au lieu-dit Sant' Anaria sur le territoire de la commune, atteste sans conteste du peuplement précoce de la piève de "Sorrinsù".
Destruction et renaissance
A la fin du XV°, la défaite des Cinarchese Giovan Paulo et Ranuccio da Leca face aux Génois de l'Office San Giorgio donna l'occasion à ceux-ci de se débarrasser de façon radicale d'une résistance qui les exaspérait. En 1489, le commissaire génois Ambroggio de Negri fit détruire et incendier les maisons et déporter dans le Celavo et en Cinarca la population de la piève. Cependant, quelques décennies plus tard les habitants, ou leurs descendants, reconstruisent et colonisent à nouveau les lieux qu'ils avaient quittés sous la contrainte.
Cependant, quelques décennies plus tard les habitants, ou leurs descendants, reconstruisent et colonisent à nouveau les lieux qu'ils avaient quittés sous la contrainte.
En témoignent :
o En 1530, Monseigneur Agostino Giustiniani dans sa "Description de la Corse", qui parle du village de "Podiolo" et d'un autre plus petit les "Soprane" (dont il reste encore la trace dans le maquis et qui comptait 14 feux sur le registre des "taglie" de 1537).
o En 1587, Monseigneur Mascardi, évêque du Nebbio en visite apostolique, qui décrit l'église de San Simeone "Plebania de Podioli de Sorrinsu" et note la présence de 160 âmes environ.
C'est en 1730 grâce aux premiers documents de «l'Etat des âmes » tenus par le curé de la paroisse que l’on peut connaître les patronymes des 81 habitants de l'époque: Ceccaldi, Demartini, Desanti, Franceschetti, Lorenzotti, Martini, Paoli, Pinelli, Vinciguerra.
Après sa victoire sur la Nation corse, l'administration royale française voulut établir un constat de l'économie de son nouveau territoire. Elle effectua pour cela en 1770 un dénombrement de la population et de ses ressources, et en 1786 mena plusieurs enquêtes en vue de l’établissement d'un plan terrier.
Une communauté travailleuse
Nous avons ainsi un tableau assez fidèle de ce qu'était la vie de nos ancêtres à cette époque.
Ils font commerce du lin, du vin et surtout du tabac qu'ils échangent pour de l'huile avec les gens de Balagne.
En somme, ils pratiquent une petite polyculture de subsistance qui les met à l'abri de la disette.
Un équilibre virgilien
Au cours du XIX° siècle, la population s'accroît régulièrement et l'exploitation du terroir environnant est à son apogée. Bien que situé à 600 mètres d'altitude, U Pighjolu jouit d'une exposition en promontoire face au Sud particulièrement favorable. L'olivier et la vigne y prospèrent et celle-ci atteint à la fin du siècle, avant la crise du phylloxera, une superficie de 30 hectares.
Oliveraies, jardins, vergers et vignes en terrasses soigneusement entretenues, entourent le village d'un environnement quasiment virgilien. Certes, la vie y est rude et laborieuse, mais les liens sociaux sont forts.
Puis cet harmonieux équilibre entre la nature et l'homme, lentement et patiemment élaboré au cours des siècles sera brutalement détruit en 1914.
Plus rien n'arrêtera alors la chute inexorable vers ce que nous connaissons actuellement.
Destruction et renaissance
A la fin du XV°, la défaite des Cinarchese Giovan Paulo et Ranuccio da Leca face aux Génois de l'Office San Giorgio donna l'occasion à ceux-ci de se débarrasser de façon radicale d'une résistance qui les exaspérait. En 1489, le commissaire génois Ambroggio de Negri fit détruire et incendier les maisons et déporter dans le Celavo et en Cinarca la population de la piève.

(armoiries de Gênes)
En témoignent :
o En 1530, Monseigneur Agostino Giustiniani dans sa "Description de la Corse", qui parle du village de "Podiolo" et d'un autre plus petit les "Soprane" (dont il reste encore la trace dans le maquis et qui comptait 14 feux sur le registre des "taglie" de 1537).
o En 1587, Monseigneur Mascardi, évêque du Nebbio en visite apostolique, qui décrit l'église de San Simeone "Plebania de Podioli de Sorrinsu" et note la présence de 160 âmes environ.
C'est en 1730 grâce aux premiers documents de «l'Etat des âmes » tenus par le curé de la paroisse que l’on peut connaître les patronymes des 81 habitants de l'époque: Ceccaldi, Demartini, Desanti, Franceschetti, Lorenzotti, Martini, Paoli, Pinelli, Vinciguerra.
Après sa victoire sur la Nation corse, l'administration royale française voulut établir un constat de l'économie de son nouveau territoire. Elle effectua pour cela en 1770 un dénombrement de la population et de ses ressources, et en 1786 mena plusieurs enquêtes en vue de l’établissement d'un plan terrier.
Une communauté travailleuse
Nous avons ainsi un tableau assez fidèle de ce qu'était la vie de nos ancêtres à cette époque.
Ils sont une centaine et vivent essentiellement des produits de leurs terres (la propriété foncière étant également répartie, ils sont tous propriétaires). Ils cultivent du seigle, de l'orge, un peu de froment, du "bled de barbarie" et transforment ces céréales en farine dans deux moulins situés en contrebas, sur les rives du Fiume Grossu. Ils soignent leurs arbres, châtaigniers, noyers, mûriers.

Pour effectuer les travaux de labour, chaque famille possède une ou deux paires de bœufs (il y en a 22 dans le village) mais, contrairement aux autres communautés de la piève, ils pratiquent peu l’élevage de brebis ou de chèvres en grands troupeaux (un seul berger).
Ils font commerce du lin, du vin et surtout du tabac qu'ils échangent pour de l'huile avec les gens de Balagne.
En somme, ils pratiquent une petite polyculture de subsistance qui les met à l'abri de la disette.
Un équilibre virgilien
Au cours du XIX° siècle, la population s'accroît régulièrement et l'exploitation du terroir environnant est à son apogée. Bien que situé à 600 mètres d'altitude, U Pighjolu jouit d'une exposition en promontoire face au Sud particulièrement favorable. L'olivier et la vigne y prospèrent et celle-ci atteint à la fin du siècle, avant la crise du phylloxera, une superficie de 30 hectares.
Oliveraies, jardins, vergers et vignes en terrasses soigneusement entretenues, entourent le village d'un environnement quasiment virgilien. Certes, la vie y est rude et laborieuse, mais les liens sociaux sont forts.
Puis cet harmonieux équilibre entre la nature et l'homme, lentement et patiemment élaboré au cours des siècles sera brutalement détruit en 1914.
Plus rien n'arrêtera alors la chute inexorable vers ce que nous connaissons actuellement.
Francescu Saveriu Paoli 
Ce texte est disponible sous forme de feuillets intitulés "Bienvenue à Poggiolo"
à la bibliothèque du village
à la bibliothèque du village
(les illustrations et les inter-titres sont de la rédaction du blog).

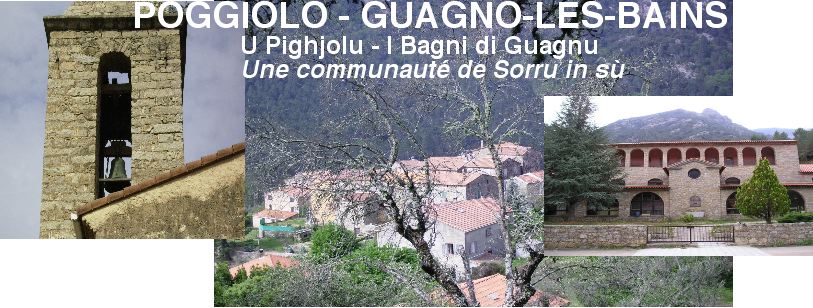


/image%2F0574608%2F20240307%2Fob_41f614_st-joseph-1er-mai-vico.jpg)
/image%2F0574608%2F20240415%2Fob_abface_carnaval-2.jpg)
/image%2F0574608%2F20240425%2Fob_1c5868_repas-sanglier.jpg)

